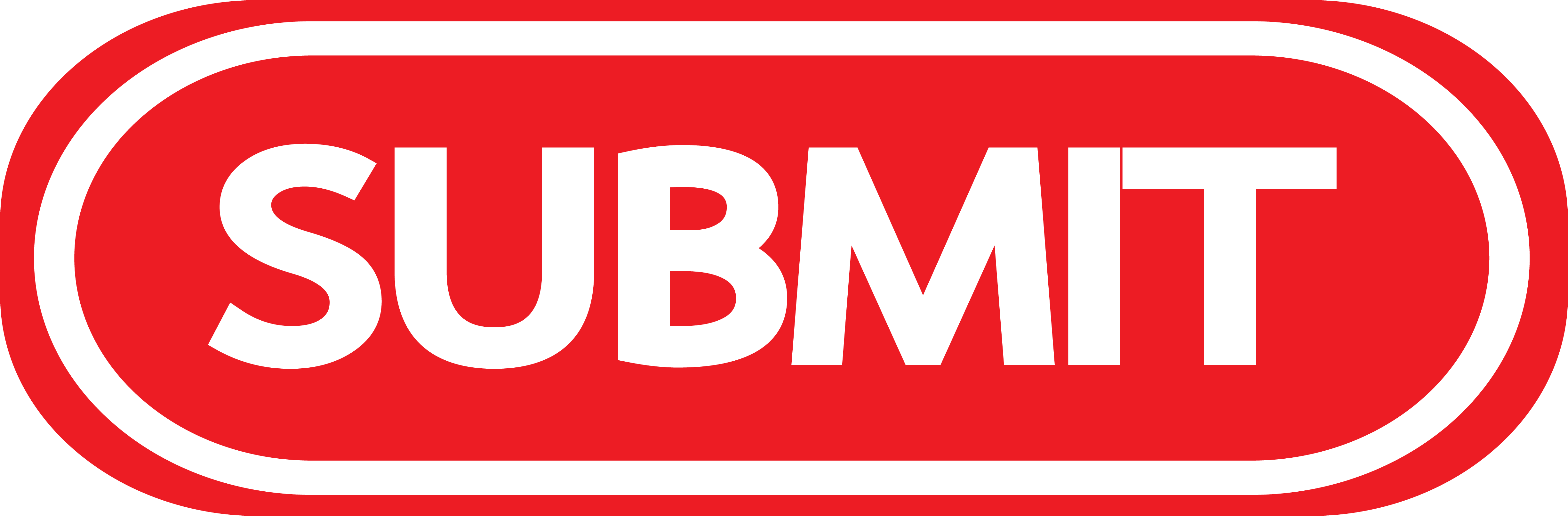Régionalisation Avancée, Emploi et Développement Économique Régional : Une Revue de la Littérature
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17561228Keywords:
régionalisation avancée ; décentralisation ; emploi, formation professionnelle ; capital humain ; croissance économique ; développement régional ; gouvernance multiniveau ; revue systématiqueAbstract
Souvent présentée comme un instrument de modernisation de l’action publique, la régionalisation avancée ne produit pas ses effets par simple décret. Elle peut améliorer l’allocation des ressources et l’emploi, mais seulement—et c’est tout l’enjeu—lorsqu’un ensemble de conditions est effectivement réuni. Appuyée sur 90 sources internationales (2000–2025) et un protocole PRISMA 2020, cette revue met en regard trois fils théoriques qui se complètent sans toujours se confondre : le fédéralisme fiscal (de la recherche d’efficience locale aux questions d’incitations et de « contraintes budgétaires molles »), la croissance endogène centrée sur le capital humain, et la gouvernance multiniveau qui, au quotidien, tient ensemble des niveaux d’autorité distincts. Les résultats apparaissent contrastés. Lorsque les régions disposent de véritables recettes propres, d’une péréquation lisible et prévisible, de capacités administratives crédibles (ingénierie de projet, systèmes d’information, évaluation) et d’instances de coordination État–régions qui fonctionnent réellement, l’autonomie tend à accélérer l’ajustement des politiques d’emploi et de formation. À l’inverse, en contexte de faibles capacités ou de transferts non financés, la décentralisation risque de fragmenter les dispositifs et d’élargir les écarts territoriaux. L’alignement formation–emploi apparaît comme la pièce maîtresse : observatoires régionaux de l’emploi, enquêtes régulières auprès des employeurs, dialogue tripartite institutionnalisé et marges d’adaptation curriculaire semblent nécessaires pour éviter le double piège d’un chômage élevé des diplômés et de pénuries persistantes de compétences dans des secteurs clés (industrie exportatrice, tourisme, services aux entreprises). Des angles morts demeurent : identification causale (endogénéité des réformes), effets sectoriels et genrés encore peu documentés, articulation avec les transitions numérique et écologique, et rareté de séries longues désagrégées au niveau régional. D’où des implications prudentes, mais opérationnelles : séquençage par étapes (pilotes, évaluation, montée en charge), asymétrie assumée selon les capacités locales, et investissement soutenu—financier et organisationnel—dans le capital humain. En bref, la régionalisation n’est ni une panacée ni une impasse ; elle paraît plutôt un cadre conditionnel dont l’efficacité dépend de la qualité des règles, des moyens mobilisés et des apprentissages collectifs au fil du temps.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.