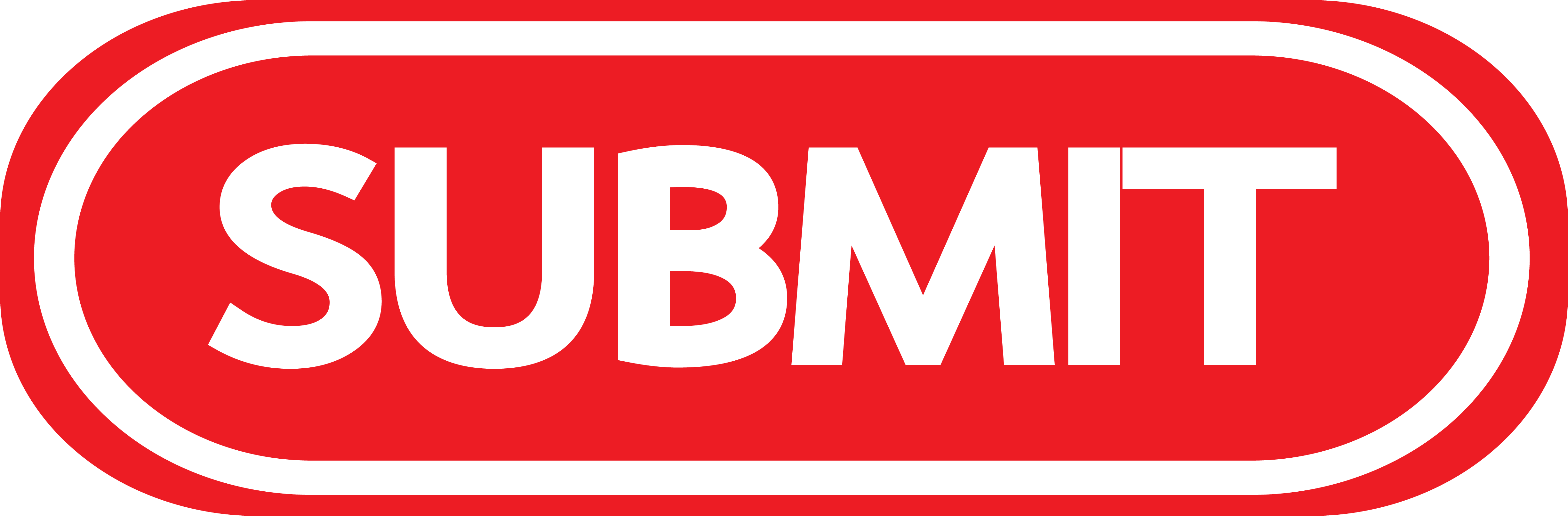LES INSTITUTIONS PUBLIQUES : DE L’ALGORITHME PROTECTEUR À L’ALGORITHME CRIMINEL
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.15773185Keywords:
Gouvernance numérique, Données personnelles, Cybersécurité, Protection des données.Abstract
Entré dans le domaine du grand public, Internet et les technologies de l’information revêtent désormais une importance majeure dans le quotidien des populations. Selon l’Union internationale des télécommunications, le nombre d’internautes dans le monde a atteint les 6 milliards en 2024, soit environ 227 millions de nouveaux utilisateurs de plus par rapport à l’année précédente. Parallèlement, une montée en puissance de la criminalité informatique fragilise les structures institutionnelles en causant des disparités dans la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel au sein des institutions publiques, qu’elles soient politiques, sociales ou juridiques. En France, malgré un cadre juridique avancé encadrant les algorithmes publics, l’expérimentation controversée d’outils prédictifs et de surveillance révèle des limites préoccupantes. Au Maroc, où la cybercriminalité est devenue une affaire d’état, la Direction Générale de la Sûreté Nationale du Maroc a lancé une nouvelle plate-forme nommée « E-Blagh » afin de lutter efficacement contre le phénomène grandissant de la cybercriminalité. Cet article se propose d’approfondir certains de ces aspects en se focalisant sur le glissement insidieux de l’algorithme protecteur vers l’algorithme criminel. En examinant les principaux risques et dérives liés à ces systèmes, il démontre la nécessité impérative d’un encadrement juridique rigoureux. Comme l’affirmait Stephen Hawking, une intelligence artificielle puissante sera « soit la meilleure chose, soit la pire chose jamais arrivée à l’humanité ».
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.